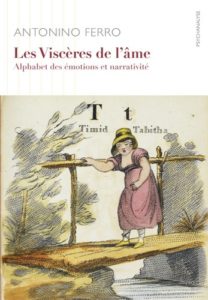Difficile de rendre compte de ce nouveau livre d’Antonino Ferro, tant il nous plonge dans l’univers d’images, de métaphores et de rêverie cher à l’auteur, très inspiré par Bion. Dans cet ouvrage datant de 2014 et traduit en français en 2019 par les éditions Ithaque qui poursuivent ainsi la publication des auteurs bioniens et post-bioniens, les rendant accessibles au public français, Antonino Ferro nous fait partager une position clinique particulière, qui s’éloigne de l’orthodoxie freudienne. Cette démarche rend parfois la lecture peu confortable, car elle va à l’encontre de nos habitudes et peut désarçonner certains lecteurs. En effet, tout en nous s’oppose « à la nouveauté qui a osé déranger les dispositifs aménagés et stabilisés depuis longtemps » (p.155).
Un chapitre s’intitule « Pensées éparses sur la technique ». Or c’est tout le livre qui est constitué de pensées éparses, et c’est ce qui en fait la difficulté et l’intérêt. Pour poursuivre la lecture, il faut accepter de déconstruire une pensée rationnelle. D’où le titre du livre, il s’agit bien des Viscères de l’âme, c’est-à-dire de la sensorialité qui sera accueillie par la réception attentive de l’analyste. Alors que le modèle freudien travaille sur les résistances, les refoulements, les souvenirs, les événements traumatiques et des personnages fortement ancrés dans la réalité historique, le modèle de Bion s’occupe des turbulences de la sensorialité dans le hic et nunc de la séance qui seront transformés par la fonction alpha. Le regard sera porté non vers le passé, mais « en direction de l’avenir, en se demandant quels éléments nouveaux pourra apporter l’analyse et quels nouveaux mondes possibles pourront être habités par un patient qui dispose de nouveaux outils pour penser » (p.20). Une telle attitude implique un certain nombre de renoncements pour l’analyste : renoncer à disposer d’une encyclopédie hypersaturée où les significations sont prévisibles et précodifiées (p.55), renoncer à la toute-puissance d’une pensée théorique, renoncer à être le seul maître à bord de la situation psychanalytique, mais partager ce rôle avec le patient, « mon meilleur collègue » comme le dit Bion. Le patient est une sorte de GPS, qui indique à tout moment où en est l’état du champ, et où le moindre détail - ce que Ferro a décrit comme les dérivés narratifs - est significatif à l’égard de l’analyse. Si tout ce que rapporte le patient, y compris ou surtout des faits qui paraissent anodins, est significatif de ce qui se passe dans le « tissage » du couple analytique, cela change radicalement l’écoute du patient. Ce changement est très inspirant, car il rend la séance beaucoup plus vivante en créant une autre dynamique. L’effet de la transformation est si rapide et permanent que Bion a pu dire que le patient qui termine une phrase n’est plus le même que celui qui l’a commencée…
Ferro se propose de raconter « de manière désordonnée mais véridique » son travail quotidien d’analyste. L’ouvrage est émaillé de très nombreuses vignettes cliniques qui témoignent de ce work in progress et illustrent l’écoute singulière de cet analyste original. On pourrait dire que Ferro - ainsi qu’Ogden ou Bollas d’ailleurs - complète l’œuvre de Bion, souvent ardu et très théorique, avec ces implications cliniques que Bion lui-même développe peu.
Sauf que Bion - et Ferro avec lui - aurait refusé le terme de bionien, car pour eux tout analyste ne peut se développer qu’en cultivant son propre style, à partir des outils que lui donnent les théories des différents auteurs. Voilà l’idée qui guide cet ouvrage et qui fonde la méthode que nous propose Antonino Ferro. Car il y a bien une méthode, malgré les apparences fantaisistes, et une méthode qui est même très rigoureuse. On retrouve l’alliance entre intuition et rigueur qui caractérise l’approche bionienne. Sur bien des points théoriques, Ferro propose des développements extrêmement précis. Ainsi pour l’identification projective, notion difficile s’il en est, voici comment Ferro la définit. « L’identification projective est une tentative naturelle d’alléger son propre psychisme en projetant des états dérangeants de fragments de sensorialité dans le psychisme de l’Autre. Si le psychisme de l’Autre est réceptif, il sera perméable à ces fragments, en leur offrant les apparences non seulement d’une dimensionnalité (ou profondeur), mais aussi d’une temporalité, à cause de l’alternance relativement prévisible des séquences concave/convexe : à cette réceptivité viendra s’additionner la capacité de transformation et d’une progressive alphabétisation des éléments projetés (bêta) qui, une fois transformés (alpha) deviendront des briques de la pensée » (p.81). On voit comment Ferro est extrêmement minutieux pour décrire ce processus complexe.
L’une des idées fondatrices d’Antonino Ferro est « que le fonctionnement mental et communicatif du patient en séance est aussi co-engendré par la position même de l’analyste, voire par l’attitude psychique de celui-ci » (p.12). Antonino Ferro fait référence à la notion fondamentale du « champ analytique » de Baranger, mais il en élargit la portée. « … dans le champ, la séance d’analyse est envisagée comme le rêve de deux esprits, où des histoires qui proviennent d’espaces et de temps différents en dehors du champ se rejoignent, se diffractent et s’entremêlent » (p.82). Entre patient et analyste se crée donc un champ qui va être habité par de multiples personnages, un véritable casting comme au cinéma, auquel Ferro se réfère fréquemment, dont le patient et l’analyste seraient les metteurs en scène, des co-scénaristes produisant un film. Ou un rêve.
Et voilà une autre idée qui constitue un fil directeur de l’ouvrage et un élément essentiel du modèle clinico-théorique d’Antonino Ferro. Le processus analytique consiste à rêver la séance. « La séance devient alors un rêve produit par les deux psychismes, qui est sans cesse régulé de sorte que les narrations et les transformations prennent la place du « non-encore pensable » (p.131). Mais pour comprendre cette idée qui peut paraître étrange, il faut se référer à la conception bionienne du rêve, très différente de celle de Freud. L’« écoute rêvante » de l’analyste, qui correspond à un processus onirique diurne, permet la transformation par la fonction alpha des récits réalistes du patient en un rêve. Il suffit, dit d’Antonino Ferro, d’écouter le récit du patient comme s’il avait commencé par « J’ai fait un rêve ».
« Rêver la séance », c’est ce que Ferro propose aux analystes en formation, dans un chapitre consacré aux supervisions, où, là encore, Ferro témoigne d’une grande originalité. Il s’agit d’éviter de formater les supervisés mais de favoriser leur créativité et leurs capacités narratives, car les interprétations sont des transformations narratives. Alors il leur fait faire des exercices qui consistent, à partir du matériel clinique exposé, d’écrire des courts textes dans une liberté totale du style et du genre narratif. Ces histoires servent au plaisir de développer les outils de pensée et aussi à multiplier les points de vue.
Un chapitre parle des abus sexuels, beaucoup plus fréquents qu’on ne le croit, dit Antonino Ferro. Pour lui, ce ne sont pas des cas isolés, ni l’effet d’une situation personnelle, mais la manifestation d’une « maladie professionnelle » liée aux responsabilités cliniques et à une suractivité anti-dépressive, chez des analystes qui n’arrivent plus à se ressourcer dans leur vie personnelle.
Antonino Ferro renouvelle aussi la conception et l’utilisation du cadre. Très souvent les analystes considèrent certaines manifestations du patient comme une manière d’attaquer le cadre et ils les interpréteront comme l’expression de la résistance au processus analytique. Pour Ferro, elles peuvent s’appréhender selon d’autres points de vue qui en révéleront des sens plus complexes. Là encore, le fait de voir autrement ce qu’on appelle de manière assez systématique des « attaques du cadre » amène à considérer que le patient contribue à constituer ce cadre, ce qui est une idée qui dérange une vision ritualisée et hiérarchique de la relation analytique.
Antonino Ferro critique les positions actuelles de la psychanalyse et s’étonne de la difficulté des analystes à admettre les changements que devraient amener les nouveaux modèles. Il se désole : « Bion, par exemple, nous a fourni des outils techniques et des théories qui devraient impliquer un changement énorme de la technique-il n’en est rien » (p.57). Il observe à quel point, dans beaucoup de groupes psychanalytiques il est inconcevable de faire un article sans forcément commencer par honorer Freud et montrer le pédigrée du concept dont on parle. Il dénonce la soi-disant neutralité, la sanctification de l’axe transfert-contretransfert et la négation du temps dans cet univers où on est un « jeune analyste en formation » à 45 ans et un « jeune superviseur » à 65… (p.74). L’une des caractéristiques du style d’Antonino Ferro – mais le style correspond à une position théorique - est de toujours parler en métaphores, et non sans humour. Ainsi, il compare la formation des analystes à « l’élevage de poules en batterie », favorisant une normopathie, empêchant de développer un style personnel.
A tout cela, inévitablement, on oppose : « Mais ce n’est pas de la psychanalyse ! », exclamation qui constitue un retour à un idéal figé produisant une censure, intériorisée en autocensure, et des positionnements analytiques infantiles et antidémocratiques. Or rien n’est figé dans cette manière de pratiquer la psychanalyse. Ferro s’ajuste à chaque patient. Parfois il parle, même beaucoup, ce qui pourrait s’apparenter à la self-disclosure américaine, qu’il évoque à plusieurs reprises avec une certaine prudence, mais parfois il se tait, car « le silence peut, telle une levure, orienter la séance vers des lieux imprévus ». L’imprévisible, voilà ce qui constitue la visée de cette position psychanalytique. Une séance créative est celle qui fait émerger des phénomènes nouveaux. Terrorisés par le non-savoir, les analystes constituent alors une « théologie psychanalytique » et projettent sur le patient leurs constructions. Terminons par une métaphore très ferrienne. « Tout se passe comme si on aspergeait des lapins blancs de vert et de bleu et qu’ensuite on affirmait avec conviction – car c’est l’évidence même ! – que les lapins sont effectivement verts ou bleus ou alors que ce ne sont pas des lapins » (p.50).
Simone Korff-Sausse